Sciences et Technologie 6e
Enseignant en primaire ?
Accompagnez-nous dans le développement d'une nouvelle collection !
Mes Pages
Thème 1 : Matière, mouvement, énergie, information
Ch. 1
Propriétés de la matière
Ch. 2
Masse et volume
Ch. 3
Mélanges
Ch. 4
Mouvement et vitesse
Ch. 5
Conversions d’énergie
Ch. 6
Lumière
Ch. 7
Électricité
Ch. 8
Transmission de l’information
Thème 2 : Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent
Ch. 9
Biodiversité actuelle et passée
Ch. 10
L'unité du vivant et sa classification
Ch. 11
Alimentation humaine
Ch. 12
La reproduction des plantes à fleurs
Ch. 13
Reproduction et sexualité humaine
Thème 3 : La Terre, une planète peuplée par des êtres vivants
Ch. 14
Vie sur Terre et réchauffement climatique actuel
Ch. 15
Fonctionnement et dynamique des écosystèmes
Ch. 16
Place des êtres vivants dans le cycle de la matière
Ch. 17
Conséquences des actions humaines sur l'environnement
Fiches méthode
Ch. 13
La petite histoire
À la folie !
Où l'on apprend pourquoi l'amour rend aveugle
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.


1819, Italie. Caché sous un grand chapeau, Stendhal
regarde discrètement une femme. L'écrivain serait-il
aussi espion ? Non, il est amoureux ! Il guette
Matilde Viscontini Dembowski qui, pour lui,
est la plus belle, la plus intelligente… bref,
la plus parfaite des femmes.
Cette idéalisation est classique, au début d'une relation amoureuse. Plus tard, l'écrivain appellera cela la « cristallisation amoureuse ». Une jolie formule qui désigne une réalité biologique : quand une relation amoureuse commence, le cerveau masque les défauts de l'être aimé.
Cette idéalisation est classique, au début d'une relation amoureuse. Plus tard, l'écrivain appellera cela la « cristallisation amoureuse ». Une jolie formule qui désigne une réalité biologique : quand une relation amoureuse commence, le cerveau masque les défauts de l'être aimé.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Quand il voit Matilde, Stendhal rougit et son
cœur s'emballe. Il manque aussi d'appétit, ne
dort plus… un vrai supplice. Et en
même temps, il se sent bien. Tout
cela vient bien sûr du cerveau,
ou plutôt des substances qu'il
produit. D'un côté, l'adrénaline et la
noradrénaline, également présentes
dans les situations de stress,
provoquent les désagréments.
De l'autre, la dopamine, « hormone
du plaisir », permet de se sentir sur
un petit nuage !

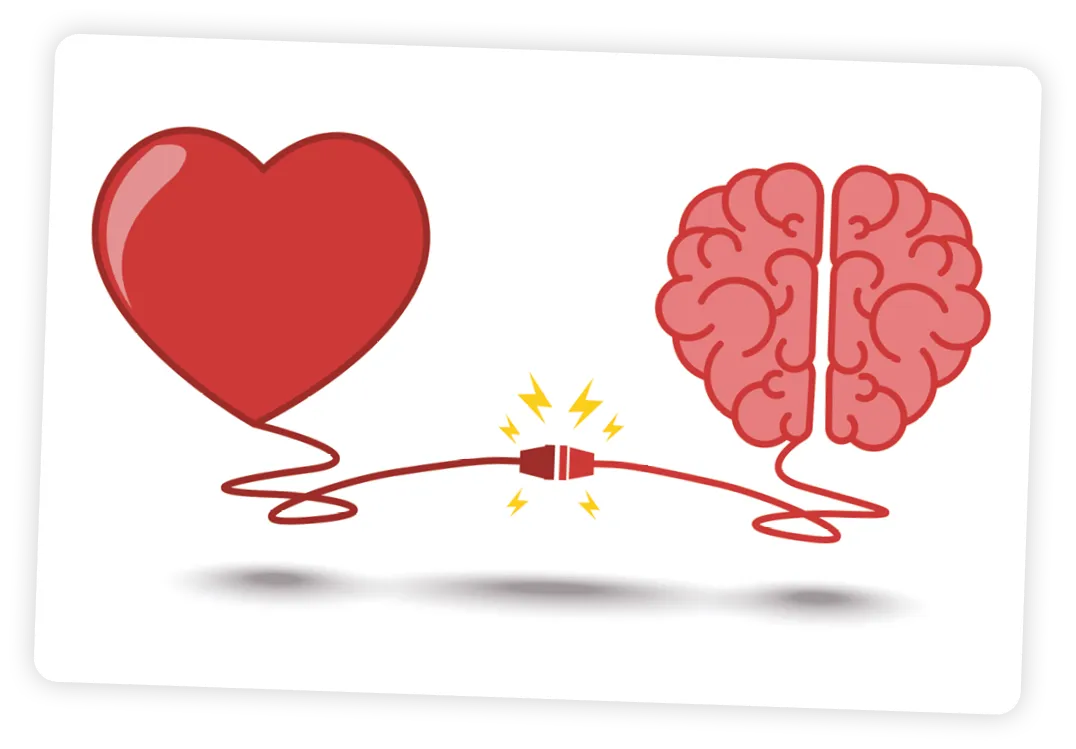
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.


Mais ce n'est pas tout : face à l'amour, notre cerveau ne serait plus capable de juger correctement les choses et les gens. Le fameux amour aveugle ! Malheureusement pour Stendhal, le cerveau de Mathilde ne s'est jamais laissé aveugler…
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Retrouve plus d'histoires comme celle-ci sur
Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille
