Français 1re
Rejoignez la communauté !
Co-construisez les ressources dont vous avez besoin et partagez votre expertise pédagogique.
Mes Pages
Repères - Histoire
Partie 1 • Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle
L’épopée antique et la chanson de geste
La fin’amor et les romans de chevalerie
Récits comiques médiévaux et humanistes
Fictions baroques
Le classicisme
Les romans épistolaires
Le romantisme
Le réalisme
Le naturalisme
Les récits de guerre
L’exploration de la conscience
Interroger l’existence humaine
Le Nouveau Roman
Les récits de vie
Partie 2 • La littérature d’idées du XVIe au XVIIIe siècle
L’humanisme à la Renaissance
Le baroque
Le libertinage
Les moralistes de l’époque classique
Les philosophes des Lumières
Partie 3 • Le théâtre du XVIIe au XXIe siècle
Le théâtre baroque
La tragédie classique
La comédie classique
Le théâtre au siècle des Lumières
Le drame romantique et le théâtre de boulevard
Les réécritures des mythes antiques
Du théâtre de la cruauté au théâtre de l’absurde
Le théâtre engagé
Les nouvelles formes de théâtre
Partie 4 • La poésie du XIXe au XXIe siècle
La poésie romantique
Le Parnasse
Les poètes maudits
Le symbolisme
Le surréalisme et l’OuLiPo
La poésie engagée : Résistance, négritude, créolité
La poésie contemporaine
Pour aller plus loin
Langue
Outils d’analyse
Méthode
Annexes
Révisions
Chapitre 1.12
Texte 5
Milan Kundera, L'insoutenable légèreté de l'être (1984)
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Texte
Les personnages de ce roman permettent d'explorer différentes facettes
de la condition humaine. Le narrateur analyse ici des manières divergentes
d'envisager les notions de vérité et de mensonge.
1. Écrivain austro‑hongrois du
XXe siècle.
VIVRE DANS LA VÉRITÉ
C'est une formule que Kafka1 a employée dans son journal ou dans une lettre. Franz ne se souvient plus où exactement. Il est séduit par cette formule. Qu'est‑ce que c'est, vivre dans la vérité ? Une définition négative est facile : c'est ne pas mentir, ne pas se cacher, ne rien dissimuler. Depuis qu'il a fait la connaissance de Sabina, il vit dans le mensonge. Il parle à sa femme du congrès d'Amsterdam et des conférences de Madrid qui n'ont jamais eu lieu, il a peur de se promener avec Sabina dans les rues de Genève. Ça l'amuse de mentir et de se cacher, car il ne l'a jamais fait. Il en éprouve un agréable chatouillement comme le premier de la classe quand il se décide enfin à faire l'école buissonnière.
Pour Sabina, vivre dans la vérité, ne mentir ni à soi‑même ni aux autres, ce n'est possible qu'à la condition de vivre sans public. Dès lors qu'il y a un témoin à nos actes, nous nous adaptons bon gré mal gré aux yeux qui nous observent, et plus rien de ce que nous faisons n'est vrai.
Avoir un public, penser à un public, c'est vivre dans le mensonge. Sabina méprise la littérature où l'auteur révèle toute son intimité, et aussi celle de ses amis. Qui perd son intimité a tout perdu, pense Sabina. Et celui qui y renonce de plein gré est un monstre. Aussi Sabina ne souffre‑t‑elle pas d'avoir à cacher son amour. Au contraire, c'est le seul moyen pour elle de vivre « dans la vérité ».
Franz, quant à lui, est certain que dans la séparation de la vie en domaine privé et domaine public se trouve la source de tout mensonge : on est un autre en privé et un autre en public. Pour Franz, « vivre dans la vérité », c'est abolir la barrière entre le privé et le public. Il cite volontiers la phrase d'André Breton qui disait qu'il aurait voulu vivre « dans une maison de verre » où rien n'est un secret et qui est ouverte à tous les regards. […]
Il faisait sa valise quand Marie‑Claude entra dans la chambre ; elle parlait des invités de la veille, approuvant énergiquement certaines remarques qu'elle avait entendues, condamnant d'un ton acerbe d'autres propos.
Franz la regarda longuement, puis il dit : « Il n'y a pas de conférence à Rome. » Elle ne comprenait pas : « Alors, pourquoi y vas‑tu ? »
Il répliqua : « J'ai une maîtresse depuis sept ou huit mois. Je ne veux pas la voir à Genève. C'est pour ça que je voyage tellement. J'ai pensé qu'il valait mieux te prévenir. »
Après ses premiers mots, il eut un doute ; son courage initial l'abandonnait. Il détourna les yeux pour ne pas lire sur le visage de Marie‑Claude le désespoir que ses paroles n'avaient pu manquer de lui causer.
Après une courte pause, il entendit : « Oui, moi aussi, je pense qu'il vaut mieux que je sois prévenue. »
C'est une formule que Kafka1 a employée dans son journal ou dans une lettre. Franz ne se souvient plus où exactement. Il est séduit par cette formule. Qu'est‑ce que c'est, vivre dans la vérité ? Une définition négative est facile : c'est ne pas mentir, ne pas se cacher, ne rien dissimuler. Depuis qu'il a fait la connaissance de Sabina, il vit dans le mensonge. Il parle à sa femme du congrès d'Amsterdam et des conférences de Madrid qui n'ont jamais eu lieu, il a peur de se promener avec Sabina dans les rues de Genève. Ça l'amuse de mentir et de se cacher, car il ne l'a jamais fait. Il en éprouve un agréable chatouillement comme le premier de la classe quand il se décide enfin à faire l'école buissonnière.
Pour Sabina, vivre dans la vérité, ne mentir ni à soi‑même ni aux autres, ce n'est possible qu'à la condition de vivre sans public. Dès lors qu'il y a un témoin à nos actes, nous nous adaptons bon gré mal gré aux yeux qui nous observent, et plus rien de ce que nous faisons n'est vrai.
Avoir un public, penser à un public, c'est vivre dans le mensonge. Sabina méprise la littérature où l'auteur révèle toute son intimité, et aussi celle de ses amis. Qui perd son intimité a tout perdu, pense Sabina. Et celui qui y renonce de plein gré est un monstre. Aussi Sabina ne souffre‑t‑elle pas d'avoir à cacher son amour. Au contraire, c'est le seul moyen pour elle de vivre « dans la vérité ».
Franz, quant à lui, est certain que dans la séparation de la vie en domaine privé et domaine public se trouve la source de tout mensonge : on est un autre en privé et un autre en public. Pour Franz, « vivre dans la vérité », c'est abolir la barrière entre le privé et le public. Il cite volontiers la phrase d'André Breton qui disait qu'il aurait voulu vivre « dans une maison de verre » où rien n'est un secret et qui est ouverte à tous les regards. […]
Il faisait sa valise quand Marie‑Claude entra dans la chambre ; elle parlait des invités de la veille, approuvant énergiquement certaines remarques qu'elle avait entendues, condamnant d'un ton acerbe d'autres propos.
Franz la regarda longuement, puis il dit : « Il n'y a pas de conférence à Rome. » Elle ne comprenait pas : « Alors, pourquoi y vas‑tu ? »
Il répliqua : « J'ai une maîtresse depuis sept ou huit mois. Je ne veux pas la voir à Genève. C'est pour ça que je voyage tellement. J'ai pensé qu'il valait mieux te prévenir. »
Après ses premiers mots, il eut un doute ; son courage initial l'abandonnait. Il détourna les yeux pour ne pas lire sur le visage de Marie‑Claude le désespoir que ses paroles n'avaient pu manquer de lui causer.
Après une courte pause, il entendit : « Oui, moi aussi, je pense qu'il vaut mieux que je sois prévenue. »
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Doc.

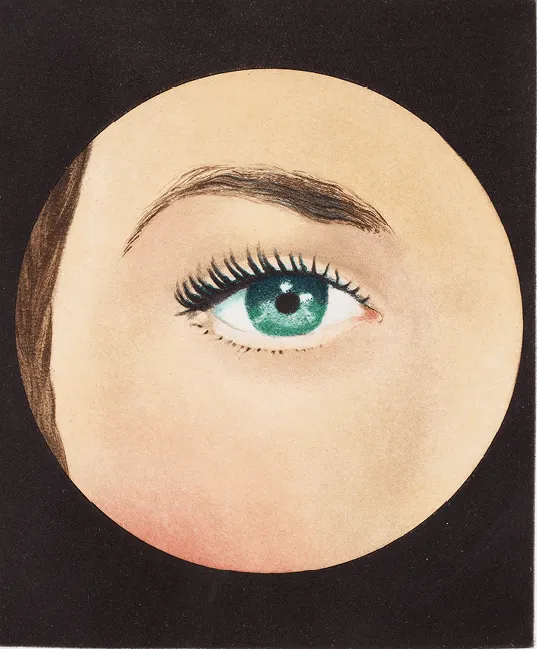
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
- Regardez une
qui analyse le roman.
- Texte A -
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Questions
1. Comment la fiction
permet‑elle de faire
réfléchir au sens de la
vérité ?
2.
2.
Grammaire
Analysez
les propositions
subordonnées relatives
dans la phrase soulignée.
Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille
