Français 1re
Rejoignez la communauté !
Co-construisez les ressources dont vous avez besoin et partagez votre expertise pédagogique.
Mes Pages
Repères - Histoire
Partie 1 • Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle
L’épopée antique et la chanson de geste
La fin’amor et les romans de chevalerie
Récits comiques médiévaux et humanistes
Fictions baroques
Le classicisme
Les romans épistolaires
Le romantisme
Le réalisme
Le naturalisme
Les récits de guerre
L’exploration de la conscience
Interroger l’existence humaine
Le Nouveau Roman
Les récits de vie
Partie 2 • La littérature d’idées du XVIe au XVIIIe siècle
L’humanisme à la Renaissance
Le baroque
Le libertinage
Les moralistes de l’époque classique
Les philosophes des Lumières
Partie 3 • Le théâtre du XVIIe au XXIe siècle
Le théâtre baroque
La tragédie classique
La comédie classique
Le théâtre au siècle des Lumières
Le drame romantique et le théâtre de boulevard
Les réécritures des mythes antiques
Du théâtre de la cruauté au théâtre de l’absurde
Le théâtre engagé
Les nouvelles formes de théâtre
Partie 4 • La poésie du XIXe au XXIe siècle
La poésie romantique
Le Parnasse
Les poètes maudits
Le symbolisme
Le surréalisme et l’OuLiPo
La poésie engagée : Résistance, négritude, créolité
La poésie contemporaine
Pour aller plus loin
Langue
Outils d’analyse
Méthode
Annexes
Révisions
Fiche de révision 1
Le roman et le récit : du Moyen Âge au XXIe siècle
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Plan de cours
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
IÉnonciation et focalisation dans le récit
L'étude d'un roman ou d'un récit nécessite de distinguer :
La situation d'énonciation correspond à la situation dans laquelle est produit le texte. Elle répond à quatre questions :
➜ qui parle ? (le locuteur ou la locutrice)
➜ à qui ? (le ou la destinataire)
➜ où ? (lieu) quand ? (temps) (= cadre spatio temporel)
La focalisation (ou le point de vue) est la position du narrateur ou de la narratrice par rapport à ce qui est raconté. Le narrateur ou la narratrice sait :
On étudie ici la façon dont le narrateur ou la narratrice intègre dans son récit les paroles prononcées par un ou des personnages.
- ce qui est raconté (l'histoire) ;
- et la façon dont l'histoire est racontée (la narration).
1La situation d'énonciation
La situation d'énonciation correspond à la situation dans laquelle est produit le texte. Elle répond à quatre questions :
➜ qui parle ? (le locuteur ou la locutrice)
➜ à qui ? (le ou la destinataire)
➜ où ? (lieu) quand ? (temps) (= cadre spatio temporel)
| Énoncé coupé de la situation d'énonciation | Énoncé ancré dans la situation d'énonciation | |
|---|---|---|
| Genres | Le plus fréquent dans les romans | Tous les dialogues, certains récits |
| Qui parle ? | Le narrateur ou la narratrice s'efface (3e personne) | Le locuteur ou la locutrice parle en son nom (1re personne) Des modalisateurs sont utilisés |
| À qui ? | Les lecteurs ou les lectrices, en général | Le ou la destinataire est identifiable |
| Quand et où ? | Cadre spatio-temporel = inconnu → Les indications spatio-temporels ne font pas référence à la situation d'énonciation : en 2020, à Istanbul, etc. | Cadre spatio-temporel = précis et connu → Les déictiques y font référence : ici, là, demain, etc. |
| Temps utilisés | Passé simple, imparfait, plus‑que‑parfait | Présent, passé composé, futur |
2Types de focalisation
La focalisation (ou le point de vue) est la position du narrateur ou de la narratrice par rapport à ce qui est raconté. Le narrateur ou la narratrice sait :
-
uniquement ce qui se déroule sous ses yeux → FOCALISATION EXTERNE
Exemple : Un homme sortit dans la rue. -
ce qui se déroule, le passé et les pensées d'un seul personnage → FOCALISATION INTERNE
Exemple : M. X sortit de chez lui fort contrarié par la décision de sa fille. -
ce qui se déroule, le passé, le futur et les pensées de plusieurs personnages → FOCALISATION OMNISCIENTE.
Exemple : M. X sortit de chez lui fort contrarié par la décision de sa fille. Celle-ci au contraire, restée plus longtemps au lit que de coutume, se réjouissait de sa résolution.
Remarque
« Omnisciente » est un mot d'origine latine qui signifie « savoir » (sciente) « tout » (omni).
Remarque
➜ Récit à la 1re personne (le narrateur ou la narratrice = un personnage) → focalisation uniquement interne.
➜ Récit à la 3e personne → les focalisations peuvent changer au cours du récit.
➜ Récit à la 3e personne → les focalisations peuvent changer au cours du récit.
3Paroles rapportées
On étudie ici la façon dont le narrateur ou la narratrice intègre dans son récit les paroles prononcées par un ou des personnages.
| Discours direct | Discours indirect | Discours indirect libre | |
|---|---|---|---|
| Définition | Le narrateur ou la narratrice rapporte directement les paroles d'un personnage, comme une réplique au théâtre. | Le narrateur ou la narratrice intègre les paroles d'un personnage à sa narration. | Les paroles sont reformulées par le narrateur mais intégrées au récit. Mélange entre le discours direct et le discours indirect |
| Exemple | Il se demanda : « Viendra-t-elle au restaurant ? » | Il se demanda si elle viendrait au restaurant comme promis. | Il attendit avec impatience l'heure du diner. Viendrait-elle au restaurant comme promis ? |
| Caractéristiques | tiret ou guillemets isolant les paroles des passages narratifs
paroles parfois introduites par des verbes de parole marques de l'oralité (familiarité, ponctuation expressive, etc) → énoncé ancré | pas de tiret, pas de guillemets
paroles rapportées dans une subordonnée complétant un verbe de parole suppression des marques de l'oralité → énoncé coupé Remarque : à la 3e personne et dans un récit au passé, il faut changer les pronoms et respecter la concordance des temps. | pas de tiret, pas de guillemets
pas de verbe de parole introducteur maintien des marques d'oralité du discours direct pronoms et temps du discours indirect → énoncé coupé |
| Effet recherché | vivacité
effet de réel mettre en valeur la manière de parler du locuteur ou de la locutrice, son milieu social | continuité du récit
rapidité, accélérer le rythme | proximité du lectorat avec un personnage |
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
IIAnalyser la structure d'un récit
1Chronologie et rythme du récit
-
Chronologie :
Toute histoire est chronologique : chaque événement succède à un autre dans une chaine temporelle linéaire.
Mais la narration d'une histoire est rarement strictement chronologique : l'ordre des événements peut varier. -
Rythme :
Le rythme de l'histoire ne correspond pas toujours au rythme de la narration.
une scène : un passage de l'histoire est raconté en temps réel.
un sommaire : un passage de l'histoire est résumé.
une pause : le narrateur s'arrête de raconter des événements pour expliquer, décrire...
une ellipse : un événement de l'histoire est passé sous silence.

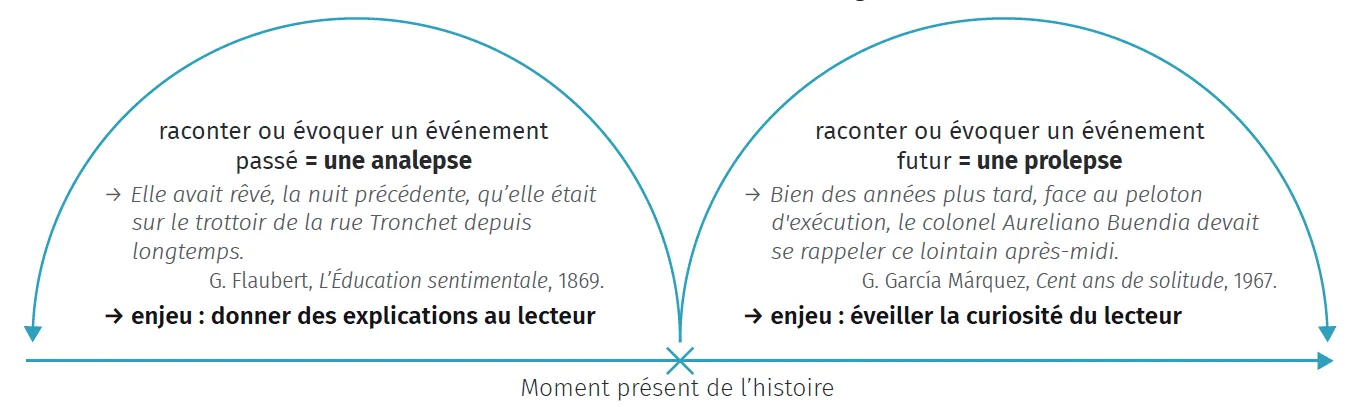

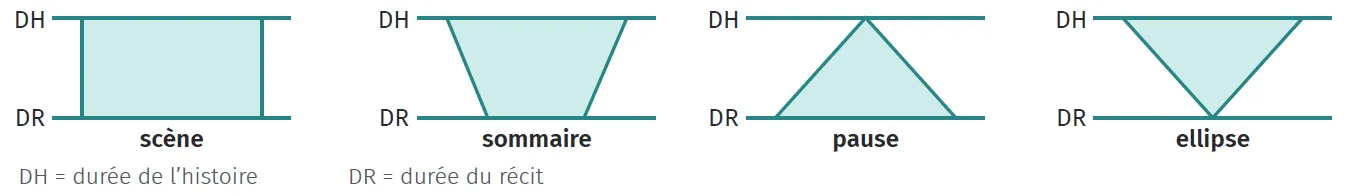
2Incipit et excipit
- Incipit : le début du récit
Remarque
Ce mot est en référence à l'expression que l'on trouve au début des manuscrits latins du Moyen Âge, incipit liber, c'est‑à‑dire « ici commence le livre ».
Enjeux possibles :
lancer l'intérêt du lectorat, le séduire
l'informer sur les personnages, le cadre spatio-temporel
établir une relation particulière entre le narrateur ou la narratrice et le lectorat (un pacte de lecture)
Enjeux possibles :
lancer l'intérêt du lectorat, le séduire
l'informer sur les personnages, le cadre spatio-temporel
établir une relation particulière entre le narrateur ou la narratrice et le lectorat (un pacte de lecture)
Remarque
On appelle « incipit in medias res » le début d'un récit qui semble prendre « en cours de route » l'intrigue et les personnages.
-
Excipit : la fin du récit
Enjeux très variés :
achever nettement le récit, clore le sort des personnages
ouvrir au contraire vers une suite possible
formuler une conclusion morale, philosophique, politique...
3La description et le portrait
- Définition : pause qui présente un lieu, un objet, une époque, un personnage (on parle alors de portrait)
Pour revoir le - Outils :
Des connecteurs spatiaux
Des connecteurs temporels
Des termes d'addition→ au centre, à droite
→ d'abord, ensuite
→ et, aussiPour organiser la description. Des verbes de perception → apercevoir, sentir, entendre Pour convoquer les sens du lecteur. Des expansions du nom (adjectif, subordonnée relative, complément du nom) → une commode de noyer dont un tiroir manquait.
Émile Zola, L'Assommoir, 1876.Pour apporter des précisions. Des comparaisons et des métaphores → La plaine paraissait, à son milieu, poudrée de farine d'amidon.
Joris-Karl Huysmans, À rebours, 1884.Pour aider à mieux imaginer ;
Pour lier l'inconnu à ce que le lectorat connait ;
Pour rendre le texte plus poétique. - Fonctions (qui peuvent se combiner) :
narrative : apporte des informations, retarde un événement
romanesque : permet au lectorat de mieux se représenter ce qui est décrit, renforce l'illusion romanesque
argumentative : permet l'expression d'un jugement du narrateur ou de la narratrice
symbolique : permet de représenter quelque chose d'abstrait (par exemple un ciel couvert de nuages pour annoncer la destinée malheureuse d'un personnage)
stylistique : montre la virtuosité du style du narrateur ou de la narratrice
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
III Les formes narratives
1La nouvelle
- Un récit court, centré sur un seul événement.
- Des personnages peu nombreux.
- Une nouvelle à chute = avec une fin surprenante
Exemples : Maupassant : Le Horla, La Parure , Boule de Suif.
2Le conte
- Suit un schéma narratif traditionnel.
- Monde imaginaire.
- Monde merveilleux dans lequel la magie existe et n'est pas surprenante.
- Épreuves à surmonter.
- Personnages-types.
- But = critiquer (la société, le pouvoir).
- Développer une réflexion sur l'être humain à travers l'imaginaire.
- Une moralité, une leçon.
- Récit en prose.
- Fiction.
- Correspondance réelle ou fictive.
- Multiplication des locuteurs et des locutrices, donc des points de vue.
- Double énonciation (chaque lettre s'adresse à un personnage mais aussi au lectorat).
- Auteur/autrice = narrateur/narratrice = personnage principal.
- Pacte autobiographique (engagement de sincérité).
- Récit rétrospectif.
- La vie de l'auteur ou de l'autrice est racontée en lien avec les événements historiques de son temps = autobiographie + témoignage historique.
- Les mémorialistes montrent leur rôle dans l'Histoire.
- Raconter l'Autre.
- Enjeux du style, du point de vue.
- Souvent, raconter l'Autre permet de se raconter.
- Genre hybride : récit, journal, lettres, poèmes, etc.
- Un témoignage, une source.
- Un regard personnel sur l'Autre, ce qui est étranger.
Conte merveilleux
Exemples : Les Mille et Une Nuits, les contes de Charles Perrault, des frères Grimm ou de Andersen.
Conte philosophique
Exemples : Candide, Zadig, Micromégas de Voltaire.
3Le roman
Remarque
Il existe beaucoup de sous-genre du roman (roman policier, roman d'aventure, roman réaliste, roman naturaliste…).
4Le roman épistolaire
Exemples : Les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, Les Lettres Persanes de Montesquieu.
5L'autobiographie
Exemples : Les Confessions de Rousseau, Histoire de ma vie de Sand.
6Les Mémoires
Exemples : Mémoires d'Outre-Tombe de Chateaubriand, Mémoires de guerre de De Gaulle.
7La biographie
Exemples : La Place d'Ernaux, L'Adversaire de Carrère.
8Le récit de voyage
Exemples : Voyage autour du Monde, Supplément au Voyage de Bougainville, L'Usage du monde de Bouvier.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
IV Les mouvements littéraires associés au récit
Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille
