Français 1re
Rejoignez la communauté !
Co-construisez les ressources dont vous avez besoin et partagez votre expertise pédagogique.
Mes Pages
Repères - Histoire
Partie 1 • Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle
L’épopée antique et la chanson de geste
La fin’amor et les romans de chevalerie
Récits comiques médiévaux et humanistes
Fictions baroques
Le classicisme
Les romans épistolaires
Le romantisme
Le réalisme
Le naturalisme
Les récits de guerre
L’exploration de la conscience
Interroger l’existence humaine
Le Nouveau Roman
Les récits de vie
Partie 2 • La littérature d’idées du XVIe au XVIIIe siècle
L’humanisme à la Renaissance
Le baroque
Le libertinage
Les moralistes de l’époque classique
Les philosophes des Lumières
Partie 3 • Le théâtre du XVIIe au XXIe siècle
Le théâtre baroque
La tragédie classique
La comédie classique
Le théâtre au siècle des Lumières
Le drame romantique et le théâtre de boulevard
Les réécritures des mythes antiques
Du théâtre de la cruauté au théâtre de l’absurde
Le théâtre engagé
Les nouvelles formes de théâtre
Partie 4 • La poésie du XIXe au XXIe siècle
La poésie romantique
Le Parnasse
Les poètes maudits
Le symbolisme
Le surréalisme et l’OuLiPo
La poésie engagée : Résistance, négritude, créolité
La poésie contemporaine
Pour aller plus loin
Langue
Outils d’analyse
Méthode
Annexes
Révisions
Outils d'analyse
Texte argumentatif
Argumentation directe et indirecte
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Leçon
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
L'argumentation directe
L'auteur ou l'autrice donne son point de vue de manière explicite, sans recourir à la fiction. L'énoncé est ancré dans la
situation d'énonciation (). Il peut y avoir des passages narratifs, mais ils servent à illustrer les arguments et
se réfèrent à la réalité.
|
• L'essai, le traité : l'auteur partage ses réflexions et son point de
vue sur un ou plusieurs sujets.
|
→ Montaigne, Essais, 1580.
→ Voltaire, Traité sur la tolérance, 1763. |
• Le pamphlet : texte court et virulent, souvent satirique.
|
→ Régnier, Satire, 1608 (par ex. la IXe s'attaque au
poète Malherbe).
|
• La lettre ouverte : lettre publique, souvent publiée dans un journal.
|
→ Rousseau, Lettre sur les spectacles, 1758.
|
• Le discours : on distingue le plaidoyer (discours de défense) et
le réquisitoire (discours d'accusation).
|
→ Rousseau, Discours sur l'origine et les
fondements de l'inégalité parmi les hommes, 1755.
|
• Les maximes : textes très courts, regroupés en recueils, qui
expriment avec concision une idée ou une vérité.
|
→ « Nos vertus ne sont, le plus souvent, que des
vices déguisés. » (La Rochefoucauld, Maximes,
1678).
|
• La préface : texte placé en tête d'un ouvrage, pour le présenter
ou le défendre.
|
→ Corneille, Préface et examen du Cid, 1660.
|
• Le dialogue d'idées : un débat d'idées entre deux personnes.
|
→ Diderot, Le Neveu de Rameau, 1891 (posthume).
|
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
L'argumentation indirecte
L'auteur ou l'autrice donne son point de vue par le détour de la fiction, ce qui peut permettre de contourner la censure,
ou de convaincre plus efficacement en suscitant la réflexion du lecteur ou de la lectrice. L'énoncé est donc coupé de la
situation d'énonciation (). Le récit a un sens symbolique à décoder.
• L'apologue, bref récit fictif contenant un enseignement moral (implicite ou explicite) est la forme principale d'argumentation indirecte. Elle regroupe les genres suivants :
• Outre l'apologue, tous les genres littéraires peuvent être argumentatifs et défendre une idée, une cause : roman à thèse (Hugo, Le Dernier Jour d'un condamné, 1829), théâtre engagé (Sartre, Les Mouches, 1943).
• La poésie engagée peut relever de l'argumentation indirecte (dans « Melancholia », Hugo dénonce le travail des enfants), mais aussi de l'argumentation directe, lorsque la thèse est défendue sans recours à la fiction (Voltaire, « Poème sur le désastre de Lisbonne », 1756).
• L'apologue, bref récit fictif contenant un enseignement moral (implicite ou explicite) est la forme principale d'argumentation indirecte. Elle regroupe les genres suivants :
|
• La fable : récit court, dont les personnages sont souvent des animaux, et qui
dénonce un travers humain.
|
→ La Fontaine, Fables, 1668‑1693.
|
• Le conte merveilleux : récit plaisant, illustrant des valeurs morales, et dont
les personnages et les lieux sont imaginaires.
• Le conte philosophique : né au XVIIIe siècle, il reprend le genre du conte pour critiquer la société ou le pouvoir. |
→ Perrault, Peau d'âne, 1694.
→ Voltaire, Candide ou l'Optimisme, 1759. |
• L'utopie : elle imagine une société idéale, critiquant en creux la société réelle.
• La dystopie : inverse de l'utopie, elle dépeint un monde terrifiant qui souligne les dangers de notre société. |
→ More, L'Utopie, 1516.
→ Orwell, 1984, 1949. |
• Outre l'apologue, tous les genres littéraires peuvent être argumentatifs et défendre une idée, une cause : roman à thèse (Hugo, Le Dernier Jour d'un condamné, 1829), théâtre engagé (Sartre, Les Mouches, 1943).
• La poésie engagée peut relever de l'argumentation indirecte (dans « Melancholia », Hugo dénonce le travail des enfants), mais aussi de l'argumentation directe, lorsque la thèse est défendue sans recours à la fiction (Voltaire, « Poème sur le désastre de Lisbonne », 1756).
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Vérifier
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
1
Choisissez la bonne réponse.
1. L'argumentation directe est ancrée dans la situation d'énonciation.
2. L'argumentation directe est orale ; l'argumentation indirecte est écrite.
3. L'utopie est une forme d'apologue imaginant une société cauchemardesque.
4. La poésie ne peut pas être argumentative.
1. L'argumentation directe est ancrée dans la situation d'énonciation.
2. L'argumentation directe est orale ; l'argumentation indirecte est écrite.
3. L'utopie est une forme d'apologue imaginant une société cauchemardesque.
4. La poésie ne peut pas être argumentative.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
S'exercer
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
2
a. Ces extraits relèvent‑ils de l'argumentation directe ou indirecte ? Justifiez.
b. Pourquoi la pièce d'Olympe de Gouges a‑t‑elle été tant critiquée ? Faites une recherche.
1. Un commerce d'hommes !... grand Dieu ! Et la Nature ne frémit pas ! S'ils sont des animaux, ne le sommes‑nous pas comme eux ? Et en quoi les Blancs diffèrent‑ils de cette espèce ? C'est dans la couleur… [...] La couleur de l'homme est nuancée, comme dans tous les animaux que la Nature a produits, ainsi que les plantes et les minéraux.
2. MIRZA. – […] Pourquoi les Européens et les habitants ont‑ils tant d'avantage sur nous, pauvres esclaves ? Ils sont cependant faits comme nous : nous sommes des hommes comme eux. Pourquoi donc une si grande différence de leur espèce à la nôtre ?
ZAMORE. – Cette différence est bien peu de chose ; elle n'existe que dans la couleur ; mais les avantages qu'ils ont sur nous sont immenses. […] Ils se servent de nous dans ces climats comme ils se servent des animaux dans les leurs.
ZAMORE. – Cette différence est bien peu de chose ; elle n'existe que dans la couleur ; mais les avantages qu'ils ont sur nous sont immenses. […] Ils se servent de nous dans ces climats comme ils se servent des animaux dans les leurs.
b. Pourquoi la pièce d'Olympe de Gouges a‑t‑elle été tant critiquée ? Faites une recherche.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
3
Les deux textes suivants abordent la question de
l'esclavage.
a. Quel type d'argumentation est utilisé dans chacun d'eux ? Justifiez.
b. Selon vous, lequel est le plus efficace ?
a. Quel type d'argumentation est utilisé dans chacun d'eux ? Justifiez.
1. Si un commerce de ce genre peut être justifié par un
principe de morale, il n'y a point de crime, quelque atroce
qu'il soit, qu'on ne puisse légitimer. Les rois, les princes,
les magistrats ne sont point les propriétaires de leurs sujets,
ils ne sont donc pas en droit de disposer de leur liberté, et
de les vendre pour esclaves.
D'un autre côté, aucun homme n'a droit de les acheter ou de s'en rendre le maître ; les hommes et leur liberté ne sont point un objet de commerce ; ils ne peuvent être ni vendus, ni achetés, ni payés à aucun prix.
D'un autre côté, aucun homme n'a droit de les acheter ou de s'en rendre le maître ; les hommes et leur liberté ne sont point un objet de commerce ; ils ne peuvent être ni vendus, ni achetés, ni payés à aucun prix.
2. Dans ce conte philosophique, l'esclave révolté Ziméo raconte
au narrateur son histoire.
Dès que notre sort fut décidé, mon épouse et son père
se jetèrent aux pieds des monstres qui nous séparaient, je
m'y précipitai moi‑même ; honte inutile ! On ne daigna
pas nous entendre. Au moment où on voulut m'entraîner,
mon épouse les yeux égarés, les bras étendus et jetant des
cris affreux, je les entends encore, mon épouse s'élança vers
moi : je me dérobai à mes bourreaux, je reçus Ellaroé dans
mes bras qui l'entourèrent […]. Ô grand Orissa !…les
Blancs enlevèrent mon épouse à mes mains furieuses ; elle
jeta un cri de douleur au moment où l'on nous désunit ; je
la vis porter ses mains à son col pour achever mon dessein
funeste ; on l'arrêta : elle me regardait : les yeux, tout son
visage, son attitude, les sons inarticulés qui sortaient de sa
bouche, exprimaient les regrets et l'amour.
b. Selon vous, lequel est le plus efficace ?
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
4
Il est certains esprits dont les sombres pensées
Sont d'un nuage épais toujours embarrassées ;
Le jour de la raison ne le saurait percer.
Avant donc que d'écrire apprenez à penser.
Selon que notre idée est plus ou moins obscure,
L'expression la suit, ou moins nette, ou plus pure.
Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement,
Et les mots pour le dire arrivent aisément.
Sont d'un nuage épais toujours embarrassées ;
Le jour de la raison ne le saurait percer.
Avant donc que d'écrire apprenez à penser.
Selon que notre idée est plus ou moins obscure,
L'expression la suit, ou moins nette, ou plus pure.
Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement,
Et les mots pour le dire arrivent aisément.
a. Reformulez la thèse de Boileau.
b. Pourquoi la retient‑on facilement ? Commentez notamment la valeur du présent et la forme du texte.
c. Cherchez les marques de première personne dans cet extrait. Que remarquez‑vous ?
d. Pourquoi peut‑on dire néanmoins qu'il s'agit d'argumentation directe ?
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
5
Visionnez le film de Steve Cutts
(3 min 27).
a. Que critique le film ?
b. De quels types d'apologues se rapproche‑t‑il ? Justifiez.
c. Selon vous, ce procédé argumentatif est‑il efficace ? Expliquez.

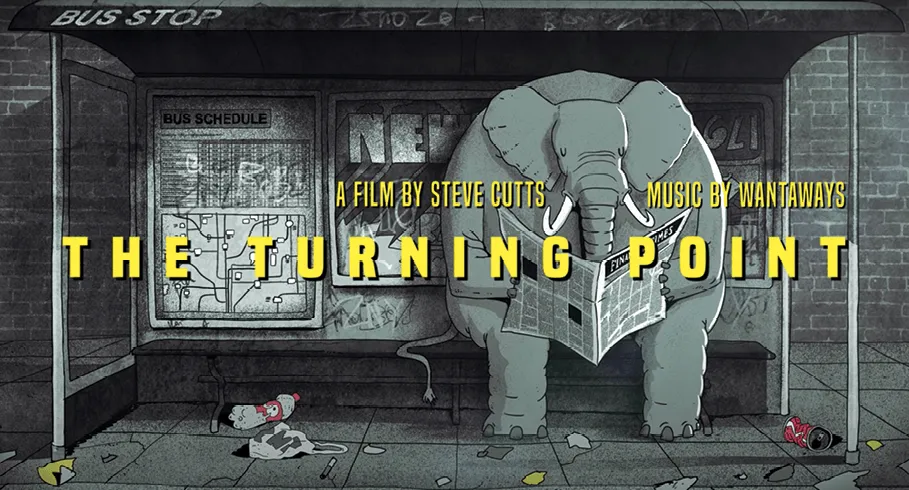 Steve Cutts, The Turning Point, 2020.
Steve Cutts, The Turning Point, 2020.
a. Que critique le film ?
b. De quels types d'apologues se rapproche‑t‑il ? Justifiez.
c. Selon vous, ce procédé argumentatif est‑il efficace ? Expliquez.

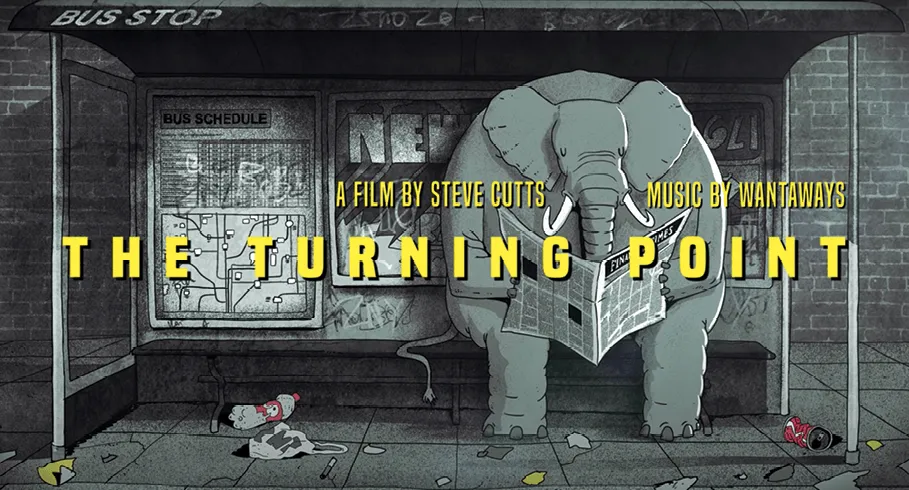
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
6
Dans cette correspondance fictive, le Persan Rica décrit à un
ami ses impressions sur la France.
a. L'énoncé est‑il ancré dans une situation d'énonciation ?
b. Pourquoi peut‑on dire cependant qu'il s'agit d'argumentation indirecte ?
c. Quelle critique implicite apparait ici ?
d. Vous parait‑elle efficace ?
Ne crois pas que je puisse, quant à présent, te parler à
fond des mœurs et des coutumes européennes : je n'en ai
moi‑même qu'une légère idée, et je n'ai eu à peine que le
temps de m'étonner.
Le roi de France est le plus puissant prince de l'Europe. Il n'a point de mines d'or comme le roi d'Espagne son voisin ; mais il a plus de richesses que lui, parce qu'il les tire de la vanité de ses sujets, plus inépuisable que les mines. […]
D'ailleurs ce roi est un grand magicien : il exerce son empire sur l'esprit même de ses sujets ; il les fait penser comme il veut. S'il n'a qu'un million d'écus dans son trésor, et qu'il en ait besoin de deux, il n'a qu'à leur persuader qu'un écu en vaut deux, et ils le croient. […] Il va même jusqu'à leur faire croire qu'il les guérit de toutes sortes de maux en les touchant, tant est grande la force et la puissance qu'il a sur les esprits.
Le roi de France est le plus puissant prince de l'Europe. Il n'a point de mines d'or comme le roi d'Espagne son voisin ; mais il a plus de richesses que lui, parce qu'il les tire de la vanité de ses sujets, plus inépuisable que les mines. […]
D'ailleurs ce roi est un grand magicien : il exerce son empire sur l'esprit même de ses sujets ; il les fait penser comme il veut. S'il n'a qu'un million d'écus dans son trésor, et qu'il en ait besoin de deux, il n'a qu'à leur persuader qu'un écu en vaut deux, et ils le croient. […] Il va même jusqu'à leur faire croire qu'il les guérit de toutes sortes de maux en les touchant, tant est grande la force et la puissance qu'il a sur les esprits.
a. L'énoncé est‑il ancré dans une situation d'énonciation ?
b. Pourquoi peut‑on dire cependant qu'il s'agit d'argumentation indirecte ?
c. Quelle critique implicite apparait ici ?
d. Vous parait‑elle efficace ?
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
Vers le bac
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Faites défiler pour voir la suite.
7
Commentaire
Montrez en quoi, dans le texte de
Montesquieu, la neutralité apparente du regard
de Rica renforce l'efficacité de l'argumentation indirecte.
Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?
Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.
j'ai une idée !
Oups, une coquille
